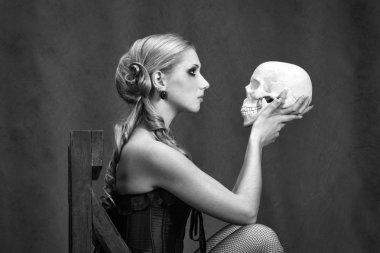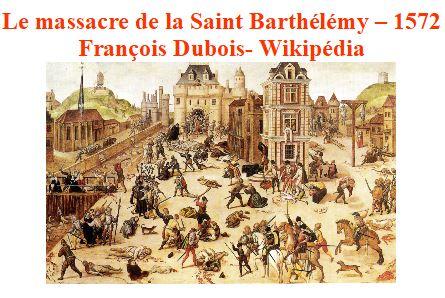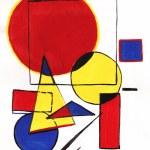Afin de présenter le thème traité le dimanche 14 décembre au café philo de Saint Herblain, veuillez trouver des textes, qui peuvent être pertinents, extraits de ChatGPT, … sur Marc BLOCH, Günther ANDERS, Emmanuel LEVINAS.
Quelles sont les différences entre l’espoir et l’espérance ? ChatGPT a dit :
Très belle question ! Les deux mots espoir et espérance semblent proches, mais ils ne recouvrent pas exactement la même réalité. Voici les principales différences :
1. Origine et usage
- Espoir : mot d’usage courant, concret, quotidien. Il désigne un souhait ou une attente, souvent liée à une situation précise.
→ Exemple : J’ai l’espoir de réussir mon examen. - Espérance : plus solennel, littéraire ou spirituel. C’est une attente confiante, tournée vers l’avenir ou vers quelque chose de plus élevé (moral, religieux, métaphysique).
→ Exemple : Les croyants vivent dans l’espérance de la vie éternelle.
2. Durée et intensité
- Espoir : peut être fragile, éphémère, parfois déçu. Il dépend des circonstances.
→ Il avait l’espoir de la revoir, mais elle ne vint pas. - Espérance : plus profonde, durable, parfois indépendante des circonstances immédiates.
→ Même dans l’épreuve, elle gardait l’espérance.
3. Dimension philosophique / religieuse
- Dans la tradition chrétienne, l’Espérance est l’une des trois vertus théologales (foi, espérance, charité). Elle exprime une confiance radicale en un avenir de salut, au-delà des aléas humains.
- L’espoir, lui, reste davantage une attente humaine, naturelle, liée aux désirs ou aux projets.
✅ En résumé :
- Espoir = attente concrète, individuelle, parfois fragile.
- Espérance = confiance durable, souvent spirituelle, tournée vers un avenir transcendant ou vers une valeur plus haute.
Bas du formulaire
Le bonheur- Quel intérêt ?- édition Méditer – 2008 – Page 28 et seq. « Le respect de la loi Morale » – Jacques Ricot
Ouvrage collectif : J Gaubert, J. Ricot, J.M. Frey, Roland Delpierre
(On pourrait s’en tenir) à l’intérieur de l’eudémonisme, et (nous observerions), entre la poursuite du bonheur et la recherche d’autres fins, tantôt une tension (avec la justice et la vérité), tantôt une complémentarité (avec la liberté et l’amitié).
Pour l’eudémonisme (doctrine morale ayant pour principe que le but de l’action est le bonheur) le bonheur est lié à la vertu, soit il en découle comme conséquence, soit qu’il s’identifie à elle. Le bonheur peut conserver dans cette perspective son statut de souverain bien, quitte à le partager avec d’autres visées comme avec la liberté, la justice, l’amitié.
Mais il est arrivé que l’on délie radicalement le bonheur et la morale… Kant est assurément celui qui a poussé le plus loin cette dissociation entre les fins humaines orientées vers le bonheur et celles dirigées vers la moralité ; « La moralité du devoir, proclame-t-il en une sentence célèbre, n’a rien à faire avec la jouissance de la vie. »
Certes, l’homme aspire au bonheur, et il ne s’agit pas de renoncer à cette aspiration, mais elle ne saurait être prise en considération dès lors qu’il s’agit de poursuivre des fins morales.
L’impératif catégorique ordonne d’être juste ou tempéré par exemple, sans conditions, alors que l dans l’impératif hypothétique, le commandement est subordonné (comme moyen) à une fin, comme dans les préceptes suivants : sois juste pour éviter la prison ; mange sobrement pour conserver la santé. En clair, la moralité exige que l’on fasse abstraction des inclinations. L’une des conséquences de l’austérité kantienne qui dissocie la vertu et le bonheur est qu’il est impossible de rapatrier la visée du bonheur au sein du pur respect de la loi morale en faisant, par exemple, du bonheur un devoir.
C’est impossible parce que le bonheur en viendrait à contaminer l’essence du devoir. Et de plus l’injonction serait contradictoire : « Ordonner à chacun de chercher à se rendre heureux serait une tâche insensée, car on ne commande jamais à quelqu’un ce que de lui-même, il veut inévitablement. »
En toute rigueur kantienne, on ne peut en aucune façon dire que le but de l’existence soit la recherche du bonheur. Mais cela n’abolit pas l’inextinguible soif du bonheur ; l ’homme, même s’il ne parvient pas à le définir autrement qu’empiriquement, continue à vouloir le bonheur inévitablement. On l’a déjà dit, la raison aux yeux de Kant ne procure pas le bonheur ; elle a une autre destination : celle d’être source de la loi morale qui se caractérise précisément par son opposition à toute considération relative à notre bonheur. La « noble » fin de la raison est la vertu, non le bonheur.
Selon Kant, il n’y a pas un lien de causalité nécessaire entre la vertu et le bonheur, contrairement à ce que pensaient les Anciens (Aristote, Stoïciens). Puisque la vertu ne produit pas le bonheur comme sa conséquence matérielle, Kant explique que la vertu doit produire le bonheur comme sa conséquence méritée. Vouloir le bonheur, c’est se vouloir digne du bonheur. Il nous est impossible de renoncer au bonheur mais il nous est impossible (interdit) de concevoir un bonheur d’après nos penchants et nous ne pouvons qu’espérer un bonheur que nous n’aurons pas recherché pour lui-même et qui soit obéissance à la loi morale.
Il est clair que le bonheur n’est pas une fin d’être digne par lui-même. Notre fin est d’être digne du bonheur en faisant notre de devoir qui est notre véritable fin.
____________________________________________