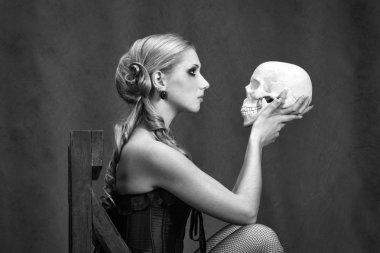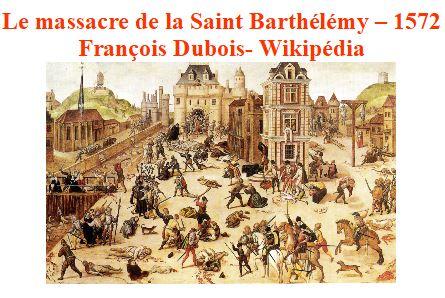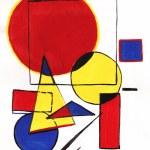Présentation du thème 06 du 8 février 2026
L’énoncé du thème envoie à un questionnement de l’adéquation de la pensée au réel, du langage au réel.
Francis Wolff déclare dans « Dire le monde » (édition augmentée – éd. pluriel, p.8) que « l’investigation philosophique ne s’inscrit clairement ni d’un côté, ni de l’autre de l’opposition entre philosophie analytique et continentale, ni dans aucune école contemporaine définie … » .
Le vide moteur de la mise en question (chapitre 1) – page 17 et seq. Extraits, In « La vocation de philosophe » – Sophie Nordmann – Calmann-Levy
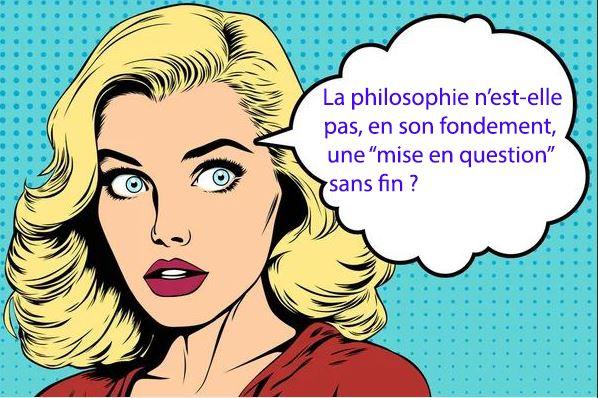
La scène originelle
N’ayant laissé aucun corpus, le Socrate historique ne lègue en héritage rien d’autre que sa vie… Socrate ne théorise pas une doctrine. Il incarne une pratique…
Nous en retrouvons l’exposition dans un passage de l’Apologie de Socrate (Platon)…
Platon y rapporte la défense de Socrate face au tribunal athénien, qui va prononcer sa culpabilité…
En réponse à ses accusateurs Socrate raconte au tribunal comment tout a commencé : un jour que son ami d’enfance, Chéréphon se trouve à Delphes, il alla consulter l’oracle pour lui demander s’il existait un homme plus sage ou savant que Socrate. A cette question, l’oracle répond que personne n’est plus «sophos» que Socrate. De retour à Athènes, Chéréphon rapporte la parole de l’oracle à Socrate, Socrate se demande ce que le Dieu peut bien vouloir dire…
Socrate s’en va interroger divers sages, « ceux qui passent pour être des savants ».
Socrate interroge un homme politique athénien qui passait aux yeux de beaucoup de gens et surtout à ses propres yeux pour quelqu’un qui savait quelque chose. Socrate conclut en ces termes…
« Je suis plus savant que cet homme-là. En effet il est à craindre que nous ne sachions ni l’un ni l’autre, rien qui vaille la peine, mais moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas imaginer que je sais quelque chose » …
Conclusion :
Dans son récit au tribunal athénien, Socrate ne retient aucun élément biographique ou doctrinal. Il est celui qui met en question la parole de l’oracle et se met en question lui-même, qui met en question ses concitoyens.
Sa vie entière est entièrement tournée vers la pratique de la mise en question. La mise en question socratique est l’acte de naissance de la philosophie. Socrate devient philosophe par la mise en question de la parole énigmatique qui lui est adressée…
Les dialogues platoniciens, qui décrivent la maïeutique de Socrate, confirment la parole de l’oracle, suivant laquelle personne n’est plus « sophos » que Socrate ; et ils donnent à savoir « l’absence effective énigmatique », qui est au cœur de la pratique socratique.
_________________________________________________________
« Le Dire et le Dit de la philosophie », in « La vocation de philosophe » , Sophie Nordmann, Calmann Levy, p.52, 2025
Brosser à repousse-poil l’histoire de la philosophie, consiste à rechercher à entendre à travers les Dits de cette histoire, ce qu’elle a à nous dire…
Nous mobilisons la distinction faite par Emmanuel Levinas du Dire et du Dit. Cette différenciation de deux dimensions du langage permet de saisir celle que nous cherchons à établir entre les deux versants de l’histoire de la philosophie…
Le Dit renvoie à l’aspect manifeste du langage, et pour nous au versant manifeste de l’histoire de la philosophie.
Le Dit correspond au contenu des énoncés… On dit toujours quelque chose, que l’on peut, interpréter, chercher à comprendre.
Mais on passe à côté d’un autre aspect du langage : le Dire.
Le Dire n’est pas un contenu, il est un acte. Avant toute parole prononcée, avant tout contenu de langage ; il y a l’acte de s’adresser à ». L’acte de Dire transcende le contenu des énoncés…Il est d’un autre ordre. Il est incommensurable au contenu objectif et manifeste du langage.
Le Dire est présent à chaque à travers chaque Dit, sans être contenu dans le Dit. « Le Dit et le non-Dit » n’absorbe pas tout le Dire, lequel reste en deçà – ou va au-delà du Dit.
Ce Dire n’est pas manifeste en ce sens que lui-même ne se dit pas : on dit toujours « quelque chose » – un Dit. Dès lors c’est seulement par et à travers le Dit que l’on peut saisir cette dimension essentielle et non ostensible du langage, car seul le Dit se manifeste au grand jour.
« Le Dire est l’infini qui échappe à la totalité des Dits. « In-fini » qui ouvre une brèche – insaisissable en elle-même comme toute brèche – dans la totalité » (Autrement qu’être) …
Comme les deux revers d’une même médaille, le Dire et le Dit sont inséparables sans pour autant se rencontrer… Pour accéder au Dire il faut une conversion du regard ou de l’écoute. Il faut pouvoir voir l’invisible, entendre l’inaudible. Pour y accéder, il faut accéder, retourner le langage, le faire vriller, afin de « réveiller dans le Dit le Dire qui s’y absorbe et qui entre, ainsi absorbé dans l’histoire qui impose le dit ».