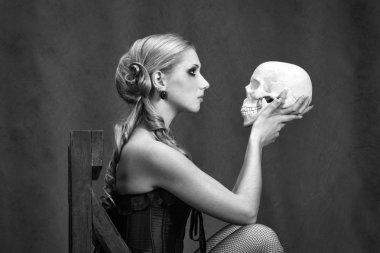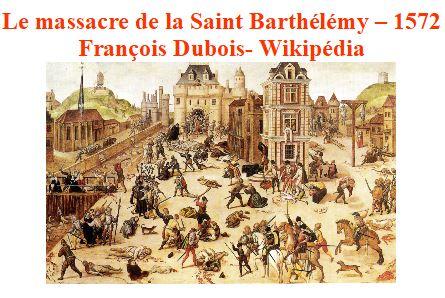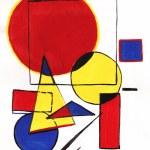Présentation du thème 02 du 12 octobre 2025
Historique de la rhétorique, très bref extrait, les Sophistes, Platon – Wikipedia
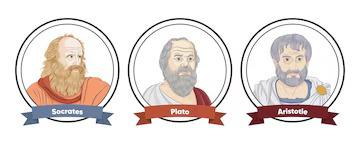
Socrate-Platon-Aristote- Freepik
Les sophistes
La rhétorique fut … rendue populaire au Vème siècle av J.C.. par des professeurs itinérants connus sous le nom de sophistes, rhéteurs itinérants qui donnaient des cours de rhétorique. L’objet central de leur préoccupation était le logos ou de manière générale tout ce qui avait à voir avec le discours. La réputation de manipulateurs, qui date des actes des sophistes, a été propagée par Platon
Les sophistes officiaient dans les discours publics et notamment à l’agora.
Leur but est avant tout pratique : permettre de comprendre les types de discours et les modes d’expression les plus à même de convaincre leur auditoire et d’accéder aux plus hautes places dans la cité. « Les Sophistes s’adressent à quiconque veut acquérir la supériorité requise pour triompher dans l’arène politique » …. Les sophistes sont en effet des enseignants réputés qui ont été les premiers à répandre l’art rhétorique.
Les sophistes les plus célèbres furent Protagoras, Gorgias, qui, auprès de Socrate, disait pouvoir soutenir n’importe quelle thèse, Prodicos de Céos, l’un des premiers à étudier le langage et la grammaire, et Hippias d’Élis, qui prétendait tout savoir.
Protagoras est considéré comme le père de l’éristique, l’art de la controverse. Son enseignement repose sur l’idée que sur n’importe quelle question, l’orateur peut soutenir deux thèses contraires, le vrai et le faux étant inutiles pour convaincre.
Il inaugure quant à lui le genre épidictique. L’enseignement des sophistes enfin est fondé sur quatre méthodes : les lectures publiques de discours, les séances d’improvisation sur n’importe quel thème, la critique des poètes (comme Homère ou Hésiode) et l’éristique (ou art de la discussion).
:
Platon : la dialectique
C’est contre les sophistes que Platon (428 av. J.-C. – env. 347 av. J.-C.) s’élève en premier lieu. Posant que la vérité doit être l’objet et le but de la rhétorique, il en vient à rapprocher art oratoire et philosophie, à travers la méthode de la dialectique : la raison et la discussion mènent peu à peu à la découverte d’importantes vérités. Platon pensait en effet que les sophistes ne s’intéressaient pas à la vérité, mais seulement à la manière d’y faire adhérer autrui. Ainsi il rejetait l’écrit et recherchait la relation verbale directe et personnelle. Le mode fondamental du discours est le dialogue entre le maître et l’élève.
Platon oppose ainsi deux rhétoriques :
- La « rhétorique sophistique », mauvaise, qui est constituée par la « logographie », qui consiste à écrire n’importe quel discours et a pour objet la vraisemblance et qui se fonde sur l’illusion ;
- La « rhétorique de droit » ou « rhétorique philosophique », qui constitue pour lui la vraie rhétorique qu’il appelle « psychagogie ».
Les deux dialogues de Platon concernant précisément la rhétorique sont le Gorgias et le Phèdre. Dans ce dernier dialogue, Socrate explique que la rhétorique use de deux procédés antagonistes : la « division » et le rassemblement
Toute l’histoire de la rhétorique en philosophie est traversée par le débat mis en forme par Platon entre la rhétorique, qui argumente sur des opinions probables et transitoires afin de convaincre, et la philosophie, qui argumente sur des vérités certaines. Toute l’histoire de la philosophie politique également en est le reflet : depuis Platon il y a une politique du vrai, de l’absolu, du dogme, et des politiques du possible, du relatif, du négociable (ce qui était précisément comment les sophistes définissaient la pratique rhétorique, fer de lance, pour eux, de la démocratie délibérative)…
__________________________________________________________
Sociologie pragmatique – Extraits de Wikipedia
La lecture de ce texte implique des pré-requis.
La sociologie pragmatique désigne une constellation de courants sociologiques français inspirés par l’interactionnisme, l’ethnométhodologie, la sociologie des sciences et les théories de l’action située, puis plus tardivement, la tradition philosophique américaine appelée pragmatisme, et communément rassemblés sous cette formule depuis le début des années 1990.
La sociologie pragmatique n’est pas un courant unifié. Elle trouve une de ses origines dans les travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot et cherche à « construire une approche qui tient compte de la capacité des acteurs à s’ajuster à différentes situations de la vie sociale ».
Description
L’ambition de la sociologie pragmatique est d’opérer une série de dépassements par rapport à ce qu’elle appelle « la sociologie classique » :
- Premièrement, elle s’efforce de dépasser l’opposition traditionnelle entre l’individu et le collectif. Elle s’inscrit par voie de conséquence dans un ensemble de travaux sociologiques cherchant à dépasser « l’opposition rituelle du collectif et de l’individuel », du holisme et de l’individualisme.
- Deuxièmement, prenant acte de l’entrée en crise des catégories sociologiques usuelles – classe sociale, statut, rôle, culture, société, pouvoir, etc. -, la sociologie pragmatique nous « invite à confectionner des outils d’analyse prenant en compte une pluralité de modes d’engagement des êtres, humains et non humains, dans le monde ».
. Troisièmement, inspirée par les travaux de John Dewey, notamment sa théorie de l’enquête, elle refuse de se situer dans une logique exclusive de rupture avec le sens commun, et s’inscrit plutôt dans un double mouvement de continuité et de discontinuité avec lui. En effet, l’enquête est postulée comme un processus au cours duquel une série d’épreuves est établie par le chercheur en relation aux personnes et aux choses de son terrain, plutôt qu’un acte de disjonction indexé sur la logique propositionnelle « vrai/faux » ou « vérité/croyance ». Il s’ensuit un renversement de perspective par rapport à la posture épistémologique d’un Pierre Bourdieu – on passe de la sociologie critique à la sociologie de la critique, selon Luc Boltanski (1990).
. Quatrièmement, elle se démarque de la sociologie de Pierre Bourdieu à laquelle elle reproche son « déterminisme » : mais aussi de l’optique de l’individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Par rapport à celui-ci, la sociologie pragmatique récuse l’idée d’un individu rationnel uniforme, calculateur et utilitariste, préférant recourir à des notions comme celle d’« actants », de « personnes » ou encore d’« êtres », qui désignent tout autant des personnes singulières que des objets, des entités morales et juridiques. Concernant les personnes – les acteurs ou agents de la sociologie classique – la sociologie pragmatique met l’accent sur la variété de leurs états en fonction des situations dans lesquelles elles sont engagées. Laurent Thévenot (2006) parle ainsi d’« une personnalité à tiroir », de la même manière que Bernard Lahire entend définir l’individu social comme « homme pluriel » (1990).
. Cinquièmement, elle s’efforce de dépasser le partage micro/macro qui a longtemps structuré la sociologie, en s’intéressant, par des voies multiples, à l’émergence de collectifs ou de mobilisations, aux formes de totalisation ou de montée en généralité, à ce qui donne une réalité substantielle aux institutions ou encore, comme dans le cas de la sociologie des alertes et des controverses, à des processus longs à travers lesquels se transforment les institutions – comme dans le cas des alertes sanitaires et des controverses sur l’usage du principe de précaution…Auteurs qui peuvent être rattachés à ce courant
______________________________________